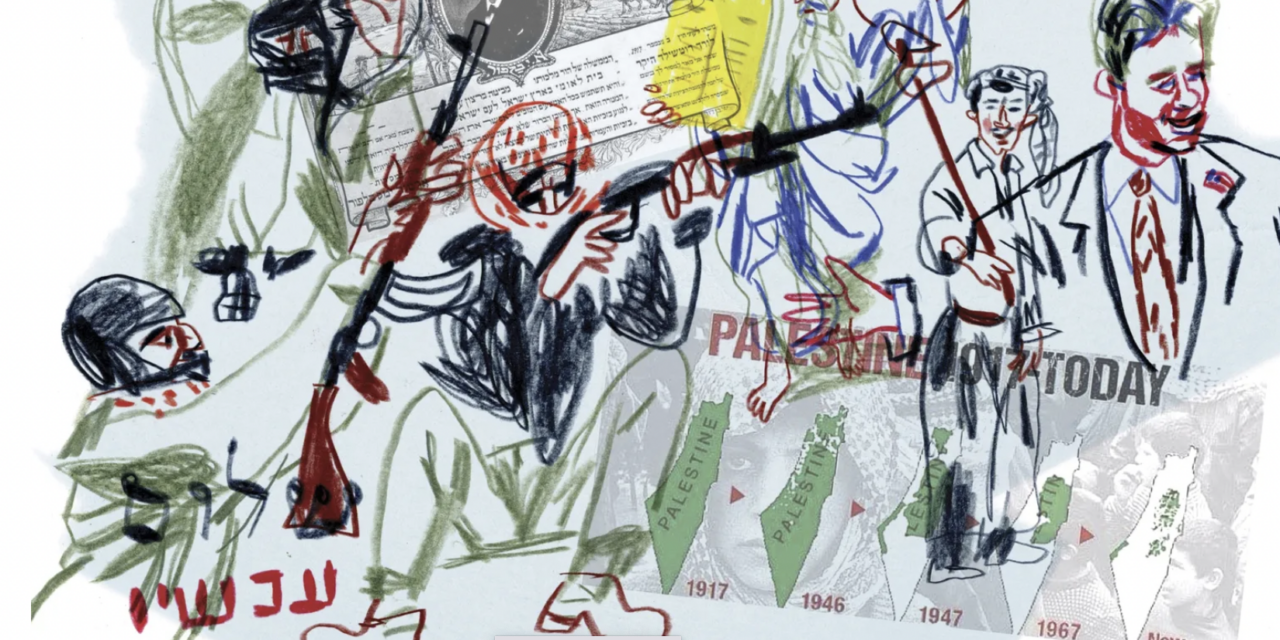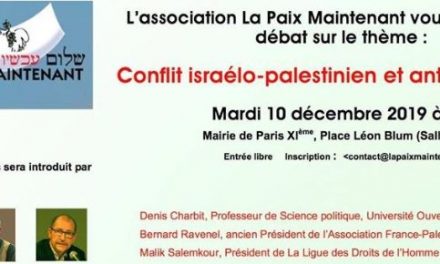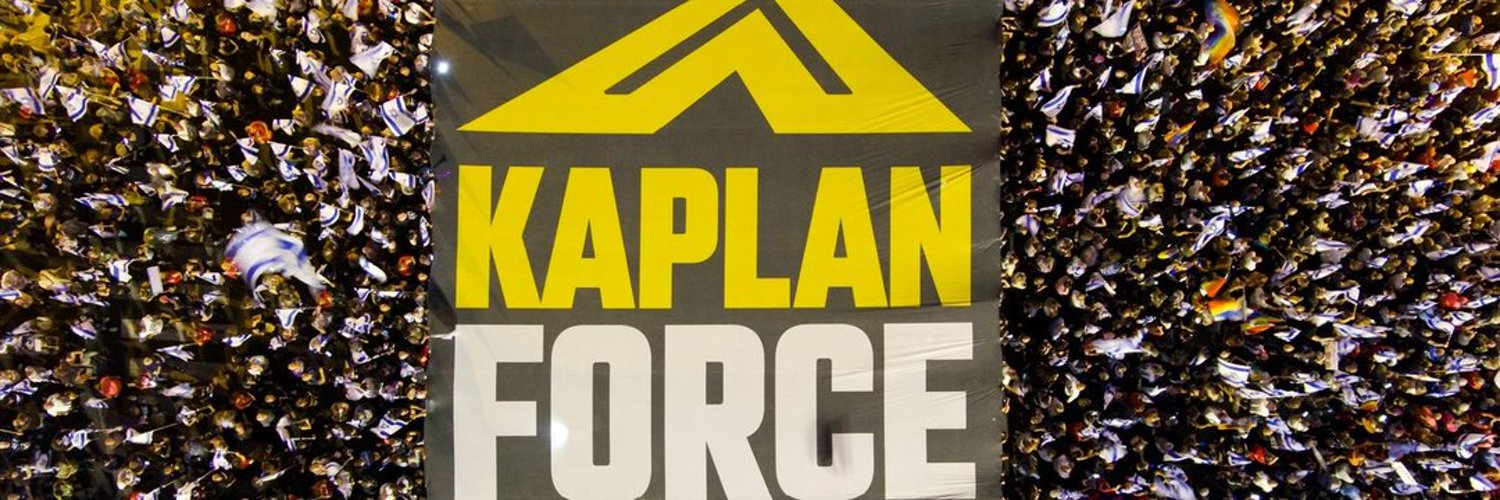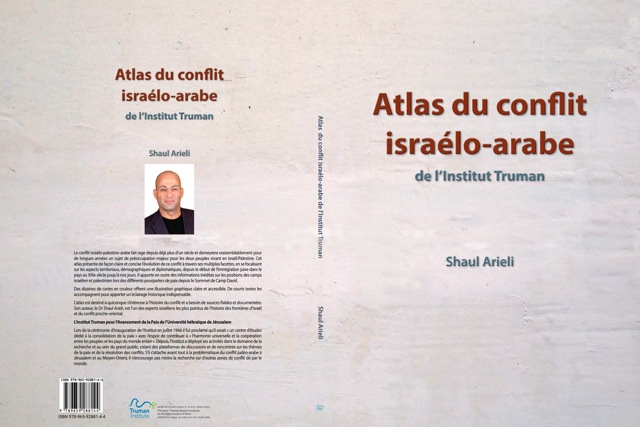Auteur : Shaul Arieli, Haaretz, 30 janvier 2025
Traduction : Version française par DORY (groupe WhatsApp « Je suis Israël »)
Illustration : Marina Grechanik
Mis en ligne le 16 février 2025
Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche sera sans doute accompagné d’une initiative en faveur d’un processus diplomatique régional, parallèlement à l’accord fragile entre Israël et le Hamas. Cela soulève la question suivante : la solution à deux États est-elle toujours viable selon les paramètres qui ont guidé les dernières négociations efficaces entre Ehoud Olmert et Mahmoud Abbas à Annapolis en 2008 ?
La réponse porte sur deux volets principaux : examiner la faisabilité dans les dimensions spatiales, démographiques, économiques, politiques et sociales – chacune étant nécessaire mais insuffisante – et créer les conditions physiques d’une séparation progressive et reconstruire la confiance entre les parties pour des négociations qui exigeront de toutes les deux qu’elles se contentent de « la moitié de leurs désirs ».
Un examen approfondi de la réalité spatiale en Cisjordanie révèle une image complexe de la répartition démographique et du contrôle de l’espace. Dans les zones A et B, qui constituent près de 40 % de la Cisjordanie, vivent plus de 2,5 millions de Palestiniens, en plus des quelque 400 000 qui résident à Jérusalem-Est. La zone bâtie de ces régions s’étend sur 710 kilomètres carrés, soit environ un quart de la Cisjordanie.
Dans ces zones, il n’y a pas de présence juive permanente, à l’exception de huit avant-postes illégaux dans la zone B, dont la moitié sont définis comme des fermes agricoles et sont habités chacun par une famille. Six d’entre eux sont situés dans la zone connue sous le nom de « Réserve consensuelle », au sud-est de Bethléem. Deux autres avant-postes se trouvent dans la région de Ramallah, l’un près de la colonie d’Ofra et l’autre dans le village de Turmus Aya. Il est important de noter que toutes les terres des zones A et B sont de propriété palestinienne, soit de l’Etat, soit de particuliers (source : « La Paix Maintenant »).
Dans la zone C, la situation est plus complexe : à la fin de 2024, on compte 134 colonies et 221 avant-postes illégaux (dont 66 établis pendant la guerre actuelle). Malgré le grand nombre de communautés juives, leur surface bâtie ne représente que 1,6 % de la Cisjordanie. En parallèle, les agglomérations palestiniennes de la zone C comprennent environ 1 100 communautés, réparties sur une superficie de 140 kilomètres carrés, soit 2,4 % de la Cisjordanie.
Une autre statistique importante est qu’environ 81 % des agglomérations palestiniennes de la zone C sont en fait une extension naturelle des communautés situées dans les zones A et B, où la construction a débordé sur la zone C. La population palestinienne de la zone C compte environ 400 000 personnes, soit 45 % de la population totale de la zone. La complexité est encore accrue par le fait que 52 % de la zone C, le cœur de la colonie de Cisjordanie, est sous propriété privée palestinienne.
Les données du Bureau Central de Statistiques pour la fin de 2024 dressent un tableau complexe de la présence israélienne en Cisjordanie : bien que la population israélienne compte 511 908 personnes, les tendances démographiques émergentes sont négatives. Cette année, comme pendant trois des cinq dernières années, le solde migratoire est négatif (plus de départs que d’arrivées), avec une baisse significative de 1 359 nouveaux arrivants en 2023 et 1 880 départs en 2024.
Ce sombre tableau se reflète à la fois dans le solde migratoire international (entre la Cisjordanie et l’étranger), qui s’est détérioré de 809 à moins 284, et dans le solde migratoire interne (entre Israël et la Cisjordanie), qui a plongé de 550 à moins 1 596. La croissance démographique repose uniquement sur l’accroissement naturel, qui est passé de 12 499 à 12 998, dont 58 % concentrés dans les communautés ultra-orthodoxes, principalement à Modi’in Illit et Beitar Illit.
Dans une perspective plus large, les colons ne représentent actuellement qu’environ 5,14 % de la population d’Israël, 15 % de la population de Cisjordanie et 55 % de la population de la zone C. Ces chiffres indiquent un changement démographique important, qui soulève de sérieuses questions sur l’avenir des colonies et leur composition sociale.
En ce qui concerne la faisabilité économique de la solution à deux États, l’examen des relations entre Israël et l’Autorité palestinienne indique une tendance à une dépendance croissante. Selon les recherches du Dr Roi Feirberg du groupe de recherche « T-Politography », Israël est le principal partenaire commercial de l’Autorité palestinienne, avec un volume d’échanges annuel de 5 à 6 milliards de dollars. Les données montrent qu’environ 65 % des importations palestiniennes proviennent d’Israël et que 85 % des exportations palestiniennes sont destinées au marché israélien.
Un autre aspect de la dépendance économique se reflète dans le marché du travail. Jusqu’au déclenchement de la guerre actuelle, environ 130 000 Palestiniens travaillaient légalement en Israël et dans les colonies, et 50 000 autres y travaillaient sans permis. La guerre a entraîné une augmentation spectaculaire du chômage dans l’Autorité palestinienne, de 25-30 % à 50-60 %. Le chômage est particulièrement élevé chez les jeunes.
Le tableau budgétaire souligne aussi la dépendance croissante des Palestiniens envers Israël. Sur le budget annuel de l’Autorité Palestinienne de 5,6 milliards de dollars, la part des taxes collectées par Israël pour l’Autorité palestinienne est passée de 40 % en 2010 à près des deux tiers aujourd’hui. Pendant ce temps, les fonds provenant des pays donateurs ont considérablement diminué, passant de 39 % à seulement 4 % du budget de l’AP. Ces chiffres reflètent une dépendance économique croissante entre l’Autorité Palestinienne et Israël, ancrée dans le « Protocole de Paris ».
La réalité démographique et économique des Israéliens présente un tableau complexe et difficile : l’augmentation de la proportion d’ultra-orthodoxes, qui constituent désormais 36 % de la population de Cisjordanie, ainsi que la baisse de la population laïque à 26 %, reflètent un profond changement dans le tissu socio-économique des colons. Statistiques notables : 37 % des colons appartiennent au groupe socio-économique le plus bas, et 9 % appartiennent aux groupes 2 et 3. Cela signifie que près de la moitié de la population vit dans une pauvreté extrême, soit dix fois la moyenne israélienne. L’État tente de combler l’écart en versant des subventions gouvernementales deux fois supérieures à la moyenne nationale, mais c’est une solution problématique et intenable.
Les données démographiques et foncières en Cisjordanie dressent un tableau clair : les Palestiniens détiennent une majorité démographique significative et une domination spatiale, tant en termes de propriété foncière que de superficie bâtie. Cette réalité place les partisans de l’annexion devant un dilemme insoluble : soit la perte de la majorité juive, soit l’abandon du caractère démocratique d’Israël.
Cependant, la séparation peut être obtenue par des échanges de terres sur 4 % de la superficie de la Cisjordanie. Une telle solution permettrait de préserver 80 % de la population israélienne vivant actuellement au-delà de la Ligne verte sous la souveraineté israélienne, tout en maintenant la continuité territoriale et le tissu de vie des Palestiniens et des Israéliens.
Le défi pratique de l’évacuation des Israéliens se concentre principalement sur les aspects de l’emploi et du logement. Une analyse détaillée des données montre que le défi peut être relevé : en termes d’emploi, puisque 50 % des colons sont des enfants, leur taux d’emploi moyen s’élève à 63 %. 62 % travaillent déjà en Israël et 6 % sont des retraités. Cela signifie qu’environ 3 500 nouveaux emplois seulement doivent être créés chaque année sur cinq ans (presque tous dans les systèmes éducatifs et sociaux). Il s’agit d’un défi modeste en comparaison du taux de création d’emplois en Israël, qui est d’environ 100 000 nouveaux emplois par an.
Pour le logement, en se basant sur la proportion d’adultes de plus de 19 ans (50 %) et le taux de mariage dans cette tranche d’âge, 6 400 logements devront être construits chaque année sur cinq ans. C’est aussi un objectif réalisable compte tenu du rythme de construction d’Israël d’environ 55 000 nouveaux logements par an. Ces chiffres soulignent que d’un point de vue spatial, la séparation entre les deux peuples dans le cadre d’une solution à deux États est réalisable, surtout si elle est mise en œuvre sur une période de cinq ans.
En ce qui concerne la faisabilité d’un accord diplomatique dans la deuxième dimension, la sphère politique, le tableau est plus complexe et comporte des défis et des contradictions. Sur la scène intérieure israélienne, le gouvernement actuel, qui s’appuie sur une Knesset où 16 députés vivent dans des colonies et des avant-postes, rejette catégoriquement tout accord incluant la création d’un État palestinien. Si on examine les décisions du gouvernement et des commissions de la Knesset au cours des deux dernières années, il n’est pratiquement pas fait mention d’une solution à long terme au conflit.
L’opposition se montre aussi réticente à revenir aux paramètres des pourparlers d’Annapolis. Parallèlement, l’OLP, malgré son soutien officiel à la solution à deux États, est confrontée à d’importants défis internes : la perte de contrôle de Gaza, l’opposition du Hamas à la solution à deux États, la division du Fatah et le manque de légitimité publique. Tous ces éléments compliquent la possibilité de faire avancer un accord diplomatique.
Cependant, le système régional a subi des changements radicaux depuis le 7 octobre. Une étude menée par le Dr Moran Zaga du groupe « T-Politography » révèle que six États arabes clés – l’Égypte, la Jordanie, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite – lient directement la fin des combats à Gaza à des progrès vers une solution diplomatique globale. Ces pays considèrent la solution à deux États comme essentielle à la stabilité régionale et promeuvent une vision commune liant l’avenir de la région à une solution durable au conflit israélo-palestinien.
La scène internationale montre une tendance similaire, avec une forte augmentation des déclarations de soutien de l’ONU et de l’UE à la solution à deux États. Aux États-Unis, malgré le déclin du soutien à cette solution depuis la victoire de Trump, on estime que l’élimination du Hamas nécessite une vaste initiative diplomatique. Le plan américain vise à établir une alliance de défense régionale sous son patronage pour contenir « l’axe du chaos et de la terreur » de l’Iran.
L’analyse révèle qu’Israël est dans un isolement diplomatique en raison de son opposition au retour à un processus diplomatique. L’avenir de sa position dépend en grande partie de la politique du futur président américain, qui devra composer avec la position arabe qui conditionne la normalisation avec Israël à des progrès sur la voie palestinienne.
En ce qui concerne la faisabilité dans le domaine social — une étude d’opinion publique menée par le Prof. Sivan Hirsch-Hoefler et le Prof. Gilad Hirschberger de « T-Politography » révèle une image intéressante des attitudes du public israélien en ce qui concerne l’avenir des territoires. Les résultats de décembre 2024 montrent une nette division : 50 % du public juif soutient la séparation des Palestiniens, soit par un accord bilatéral (25 %), soit par une action unilatérale (25 %). L’autre moitié est favorable au maintien du contrôle israélien, soit par une annexion formelle, soit par le maintien du statu quo.
Deux tendances marquantes émergent au fil des ans dans le public juif israélien : une baisse spectaculaire du soutien à la solution à deux États, de 47 % en novembre 2018 à 25 % à la fin de 2024, et simultanément, une augmentation significative du soutien au maintien du statu quo, de 9 % à 22 % au cours de la même période. Le soutien à l’annexion est également passé de 17 % à 28 %. Ces changements reflètent un processus profond qui a commencé avant même les événements d’octobre 2023.
Parmi les citoyens arabes d’Israël, la situation est tout à fait différente : 84 % d’entre eux soutiennent la séparation, dont 58 % dans le cadre de la solution à deux États. De plus, les recherches du Dr Maoz Rosenthal de « T-Politography » sur le discours tel qu’il s’exprime sur les réseaux sociaux, les déclarations des dirigeants des partis et la presse écrite (« Haaretz », « Israel Hayom », « Yedioth Ahronoth ») révèlent qu’aucune discussion significative sur une solution permanente au conflit israélo-palestinien n’a lieu.
Du côté palestinien, les enquêtes menées par l’Institut pour le progrès social et économique indiquent que 69 % des Palestiniens soutiennent la solution à deux États sur la base des frontières de 1967, et 42 % soutiennent un État avec des droits égaux. Les recherches du Dr Ronit Marzan et de Sigalit Maor de « T-Politography » indiquent un changement significatif dans le discours des influenceurs palestiniens sur les réseaux sociaux : une diminution de 80 % de l’utilisation de termes liés à l’activisme militaire et religieux, au profit de discours mettant l’accent sur l’activisme médiatique, culturel et politique.
Ce n’est qu’après avoir établi une confiance mutuelle et prouvé que les Palestiniens sont capables de gouverner, que des négociations de fond pourront être menées sur un accord permanent. La voie à suivre passe nécessairement par une étape intermédiaire : des élections de chaque côté, le transfert progressif des territoires de la zone C à l’Autorité palestinienne et la réhabilitation de la connexion entre Gaza et la Cisjordanie. Il ne s’agit pas d’un fantasme, mais plutôt d’une réalité complexe qui exige un leadership courageux de la part des deux parties.